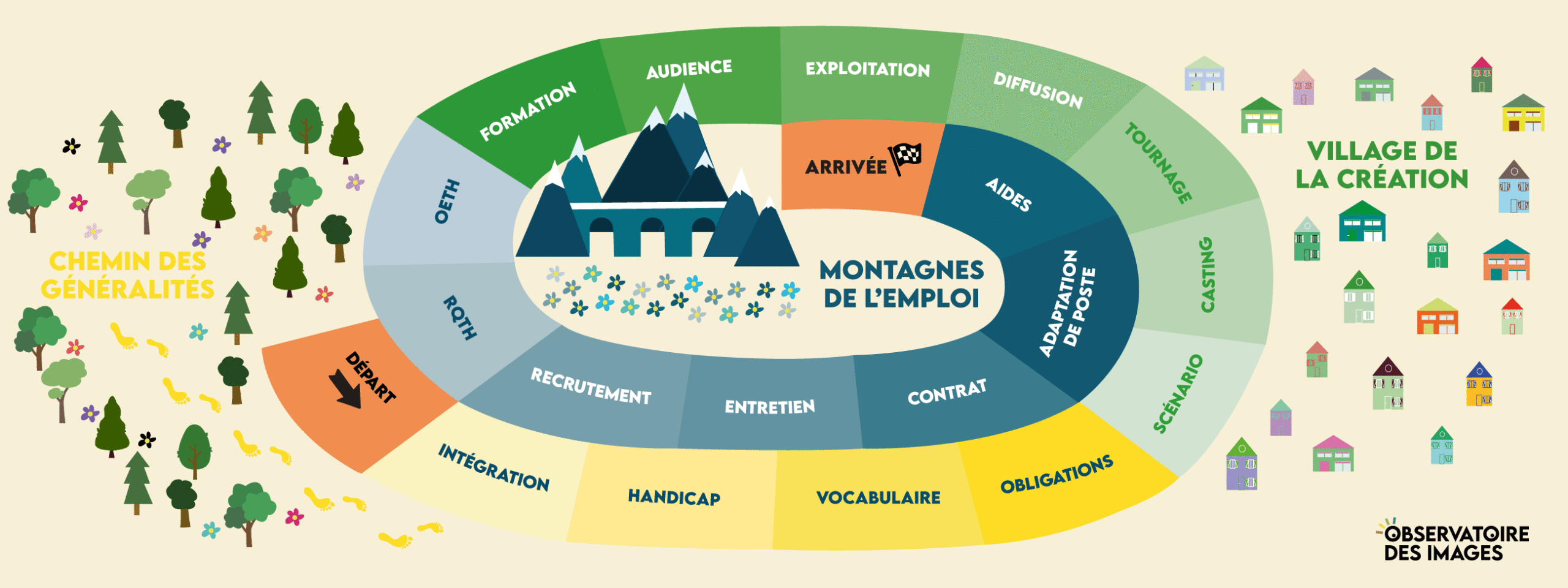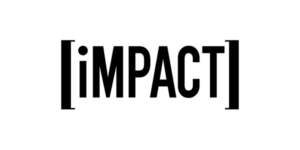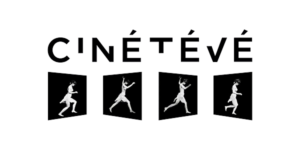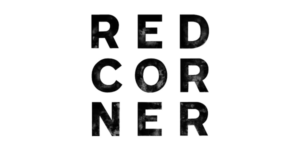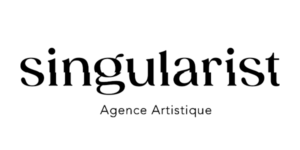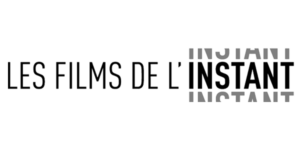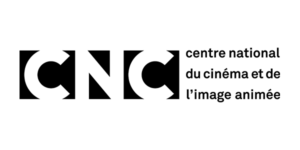© 2026 Copyright – Observatoire des Images
UNE BASE DE CONNAISSANCES DÉVELOPPÉE AVEC L’AIDE DU CNC, DANS LE CADRE DE L’APPEL À PROJET LES UNS ET LES AUTRES.
Départ
Comment contribuer à une meilleure intégration des personnes handicapées dans notre univers, que ce soit dans les bureaux ou sur les tournages, devant ou derrière la caméra ?
Les personnes en situation de handicap sont largement exclues du secteur audiovisuel et cinématographique : un secteur qui, pourtant, crée et véhicule des représentations pour le reste de la société.
16% des français.es sont handicapé·ées, pourtant seulement 0,6% des personnes apparaissant à la télé sont perçues comme étant handicapées*. Parmi elles, 67 % sont des hommes et 90% sont perçus comme blancs*. 80 % des handicaps ne sont pas visibles et seules 15 % des personnes handicapées le sont depuis leur naissance ou avant leurs 16 ans. Entourage, familles, amis, collaborateurs de personnes handicapées… un nombre d’autant plus important de personnes sont directement concernées et confrontées au quotidien à ces problématiques sans pour autant être représentées.
Au delà d’un impératif légal, administratif ou financier, intégrer des personnes handicapées dans notre univers c’est s’ouvrir à la réalité d’une société où tout le monde n’est pas blanc, hétérosexuel, cisgenre, valide.
Cela implique de se renseigner, s’adapter, évoluer, mais aussi d’être accompagné et aidé par des structures spécialisées.
Le contenu de cette base de connaissances vise à donner les outils et contacts nécessaires aux acteurs du secteur quels qu’ils soient (auteurs, producteurs, diffuseurs) pour effectuer une transition vers une meilleure intégration des personnes handicapées et transformer durablement leurs pratiques.
Source : Baromètre de l’Arcom, La représentation du handicap à l’antenne et l’accessibilité des programmes de télévision aux personnes en situation de handicap – Rapport 2021
Niveau 1 : S’informer, le B.A.-BA du handicap dans le secteur audiovisuel
Pourquoi est-il important d’intégrer les personnes en situation de handicap dans les secteurs audiovisuel et cinématographique ?
Les personnes en situation de handicap sont sous-représentées parmi les employés des médias et de l’audiovisuel. Au-delà de l’apparition à l’écran, des études révèlent que le taux d’inclusion des personnes en situation de handicap au sein des médias européens est entre 1 et 8% selon les pays européens tandis que 16% de la population est handicapée : ce chiffre reste largement insuffisant.
Ce manque d’intégration des personnes en situation de handicap pose problème, car ce sont ces mêmes personnes qui vont participer à la construction des images, et donc des représentations. En effet, les membres du secteur audiovisuel et du cinéma façonnent par leur travail quotidien les représentations qui circulent dans la société, tout en étant largement influencés par cette dernière. Il existe ainsi un continuum entre les salariés du secteur et les représentations qui en découlent, et on peut imaginer qu’améliorer l’employabilité des personnes en situation de handicap derrière la caméra permettra de meilleures représentations, et vice-versa.
Qu’est ce qui relève du handicap ?
En France, la définition du handicap est donnée par l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, issu de la loi du 11 février 2005. Ainsi, constitue un handicap : “toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou trouble de santé invalidant”.
Il y a une grande variété de handicaps, que l’on peut classifier en plusieurs familles* :
- le handicap moteur. Il concerne les personnes qui rencontrent des difficultés pour se déplacer, effectuer certains gestes, porter du poids. Elles peuvent aussi avoir du mal à conserver ou changer leur position. Contrairement à ce que l’on pense, moins de 5 % des personnes handicapées moteur utilisent un fauteuil roulant ;
- les troubles du neuro-développement. Elle regroupe :
- le trouble du spectre de l’autisme
- le handicap psychique, qui recouvre différents troubles de la personnalité. En général, ils n’affectent pas les capacités intellectuelles, mais ont des conséquences sur le raisonnement, la communication, le comportement ;
- le handicap mental : Il se rapporte à une déficience intellectuelle. Elle se traduit par des difficultés de réflexion, de communication et de décision ;
- le handicap cognitif : il entraîne des troubles de l’attention ou de la perception, comme par l’exemple la dyslexie ;
- le handicap sensoriel : il est relatif aux éléments visuels (perte de la vue totale ou partielle) ou auditif (perte auditive totale ou partielle, acouphènes) ;
- les maladies invalidantes comme notamment le cancer, le VIH, les allergies ou le diabète. Elles peuvent entraîner des problèmes moteurs, de la fatigue ou des contraintes liées à des traitements.
80 % des handicaps ne sont pas visibles et seules 15 % des personnes handicapées le sont depuis leur naissance ou avant leurs 16 ans. En France, on estime que 16% de la population est en situation de handicap – ce ratio est comparable à ceux observés dans d’autres pays comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis ou encore l’Allemagne.
Source : Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
Quel est le vocabulaire adapté à utiliser en présence de personnes en situation de handicap ?
Lorsque l’on commence à découvrir le sujet, il n’est pas rare de se questionner sur les bons mots à utiliser : personne handicapée, déficience, personne en situation de handicap (PSH) ? Il n’y a pas de recommandation précise, et deux personnes différentes donneront deux réponses différentes. L’Organisation des Nations unies utilise, par exemple, le terme « personnes handicapées ». La meilleure solution reste de poser la question aux personnes concernées, ce qui démontre une certaine attention et délicatesse.
Pour aller plus loin :
- des guides et des listes de vocabulaire pour adapter le vocabulaire se trouvent sur le site de l’association La compagnie des aidants (en français) ou sur celui de l’association américaine Respectability.
En tant qu’employeur, quelles sont mes obligations ?
Il existe, depuis le 1er janvier 2020, une obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Ainsi, toutes les entreprises de plus de 20 salarié·es ont l’obligation d’employer directement 6% de personnes en situation de handicap (5% à Mayotte), sous réserve de verser une contribution financière annuelle à l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (ou Agefiph) d’environ 4000€ HT par travailleur en situation de handicap qui aurait dû être employé. Pour plus d’informations, cliquez ici.
À noter : Si cette obligation légale concerne une minorité des entreprises du secteur audiovisuel et du cinéma – la majeure partie des structures comptant moins de 20 salarié·es – l’inclusion est l’affaire de tous et a un fort impact sur les représentations proposées. Pour plus d’informations, cliquez-ici.
Niveau 2 : Mener un travail de réflexion sur l’inclusion, de l’écriture à la diffusion
Quelles questions se poser lors de l’écriture / la lecture d’un scénario ?
La représentation du handicap à l’écran est malheureusement trop souvent absente, ou alors traitée de manière stéréotypée, associée à des comportements stigmatisants… alors que le handicap pourrait être intégré dans des récits sans qu’il soit nécessaire d’insister dessus ni d’en faire un enjeu narratif.
Pour proposer une représentation authentique des personnes en situation de handicap, se poser les questions suivantes*.
Pour écrire un scénario :
- Est-ce que je peux mobiliser, dans mon entourage et mes réseaux, une personne porteuse du handicap concerné susceptible de partager son vécu et de m’accompagner dans le processus d’écriture pour une vraisemblance maximale ?
- Est-ce que je possède suffisamment d’informations et de connaissances sur le handicap à intégrer dans le récit pour le faire de manière authentique ?
Pour lire un scénario :
- Si le contenu est intrinsèquement lié au thème du handicap ou si un personnage important est en situation de handicap : est-ce qu’une personne (auteur·ice, consultant·e) qui présente le même type de handicap a participé à l’écriture ?
- Des experts des questions du handicap (personne en situation de handicap, personnel médical, etc) ont-ils été consultés ?
Dans tous les cas :
- Le handicap est-il représenté de manière positive, négative ou neutre ?
- Est-ce que le handicap est utilisé comme élément d’intrigue pour faire avancer l’histoire ?
- Est-ce que le handicap sert de faire valoir pour montrer l’empathie d’une personne valide ?
- Le handicap est-il intégré dans un arc narratif et pas un arc narratif en tant que tel ?
- Comme dans la vie, le handicap peut toucher n’importe quel personnage, peu importe son origine ethnique, sociale, son âge, son orientation sexuelle, etc ; est-il traité de manière inclusive ?
- Est-ce que le handicap est utilisé pour justifier le comportement négatif d’un personnage, notamment s’il s’agit d’un antagoniste ?
- Est-ce que le handicap est utilisé comme un moyen de faire rire aux dépens du personnage concerné ?
- Est-ce que la manière dont le handicap est intégré dans le récit est stigmatisante pour les personnes en situation de handicap ?
- Le récit met-il en valeur les bénéfices d’un accompagnement thérapeutique ?
- Les tropes et les représentations stéréotypées sont-ils évités ?
En cas de doute, ne pas hésiter à faire accompagner par des personnes en situation de handicap, des experts ou des associations pour proposer une représentation honnête et non stéréotypée.
Pour aller plus loin :
- des listes de tropes liés aux représentations des personnes en situation de handicap sont disponibles sur internet, par exemple en français sur le site du service de sensitivity reading Lecture sensible ou anglais dans le livre blanc Roadmap for inclusions de la Ford Foundation.
Source : étude MENTAL HEALTH CONDITIONS IN FILM & TV, USC ANNENBERG
Quelles questions se poser au moment du casting ?
La réalité de la population est encore trop peu montrée dans la fiction. Pour qu’elle soit plus juste, les films, les séries doivent être inclusives dans le sens de la représentation réelle : parce que tout le monde n’est pas blanc, hétérosexuel, cisgenre, valide. Bien sûr, ce ne sera pas toujours possible compte tenu des histoires/des projets, mais c’est une question à laquelle il faut répondre à chaque étape du processus, y compris au casting.
Aujourd’hui, les rôles de personnages en situation de handicap sont majoritairement tenus par des acteurs valides. Ainsi, à la télévision américaine, 95% des rôles de personnage en situation de handicap sont joués par des acteurs valides*. Les “castings authentiques”, c’est-à-dire des rôles de personnes en situation de handicap occupés par des talents en situation de handicap présentant un handicap correspondant à celui du rôle, concernent majoritairement les rôles les moins récurrents : dans 71% des cas de casting authentique dans des séries TV, il s’agissait de rôles présent dans moins de 5 épisodes*. Il est possible de s’appuyer sur des agences spécialisées dans la représentation de talents en situation de handicap ou des associations pour trouver les bons profils de talents, comme l’agence Singularist ou l’agence Colette.
De manière générale, il faut considérer caster des personnes en situation de handicap dans tous types de rôle, des personnages principaux aux figurants, qu’ils soient écrits ou non pour des personnes en situation de handicap. Le handicap ne sera pas forcément un sujet en soi dans l’histoire, mais juste un choix au moment du casting. On peut avoir un personnage en situation de handicap et rendre ses problèmes universels, de sorte qu’ils parlent à tout le monde ! Ce qui est vraiment important, c’est d’éviter les stéréotypes et les clichés car la représentation des personnes en situation de handicap est souvent stigmatisante.
Aussi, garder en tête une approche intersectionnelle : à la télévision françaises, les personnes en situation de handicap demeurent majoritairement des hommes (67 %) et sont perçus comme blancs (90 %)*, ce qui ne correspond pas à la réalité du handicap qui concerne aussi les femmes et les personnes racisées. Ces chiffres révèlent à quel point les personnes en situation de handicap sont largement exclues du secteur et la nécessité de transformer durablement et significativement les pratiques.
Lors de l’organisation des castings, anticiper l’accessibilité :
- sur la logistique : vérifier que les lieux choisis pour les castings sont accessibles (situation géographique, absence de marches, présence d’ascenseur, éclairage adaptable, etc) ;
- sur le déroulé : ne pas hésiter à se renseigner auprès de l’agent du talent afin d’en savoir plus sur l’étiquette à adopter et anticiper des besoins spécifiques, comme par exemple la présence d’un interprète en langue des signes ou une transcription d’un scénario en braille.
Sources : Etude américaine Road Map for Inclusion ; Ruderman Foundation Authentic Representation WP 2020 ; Baromètre de l’Arcom, La représentation du handicap à l’antenne et l’accessibilité des programmes de télévision aux personnes en situation de handicap – Rapport 2021
Comment rendre mon tournage inclusif ?
Lors de l’organisation des tournages, il est nécessaire d’anticiper l’accessibilité des différents lieux (plateau, cantine, sanitaires, zones de repos, logements, etc), entre ces lieux (transport, etc) et du matériel technique. Une attention particulière doit être portée à l’intérieur des hébergements et espaces personnels (sanitaires, douches, etc).
Pour cela, il faut demander en amont du tournage aux talents et membres des équipes techniques leurs besoins et les dispositifs d’aide nécessaires. Une personne en situation de handicap peut par exemple avoir besoin d’un accompagnant externe, d’un interprète en langue des signes etc.
Toutes les personnes dépendantes (personnes en situation de handicap, enfant, personne âgée etc) bénéficient du même droit à l’accompagnement. Ainsi, sur un tournage par exemple, les frais de voyage, logement, repas de l’accompagnant doivent être pris en charge par la production.
Les réponses arrivant parfois tard (voire après le tournage), il est impératif de garder en tête les obligations humaines avant économiques : ne pas attendre d’avoir eu une réponse positive d’aide pour mettre en place l’accompagnant, par exemple.
Comment rendre la diffusion de mon film / série / … inclusive ?
L’accessibilité d’un film ou d’une série aux personnes en situation de handicap est liée aux dispositifs de sous-titrage sourds et malentendants (ST-SME), d’amplification (HI) et d’audio-description (AD). Quelques conseils pour les améliorer :
- Penser le cadre pour la présence de sous-titres ;
- Réaliser le sous-titrage pendant le montage et le tester au même titre que les autres éléments auprès de personnes en situation de handicap ;
- Prévoir du temps et un budget pour le sous-titrage sourds et malentendants et pour l’audio-description.
En termes de coûts, l’Arcom donne les estimations suivantes du coût horaire moyen : de 249 € HT à 625 € HT pour le sous-titrage d’un programme ; plus de 2 500€ pour la traduction en langue des signes ; entre 1 500€ et 3 600€ pour l’audio-description. Le CNC a mis en place des aides financières afin d’élargir l’offre d’œuvres cinématographiques accessibles aux spectateurs en situation de handicap. Pour plus d’informations, cliquez-ici.
Pour aller plus loin :
- le site Ciné-Sens propose des fiches-guide sur l’audiodescription et le sous-titrage dans la rubrique Ressources ;
- le guide Cinéma et accessibilité publié par le Ministère de la Culture en novembre 2018 peut servir de référence pour la réalisation du sous-titrage sourds et malentendants et l’audio-description ;
- la boîte à outils A Toolkit for Inclusion & Accessibility: Changing the Narrative of Disability in Documentary Film tirée du documentaire américain Crip Camp est une référence en termes d’accessibilité et d’inclusivité ; publiée en février 2021 par la FWD-Doc.
Comment rendre l’exploitation de mon film / série / … inclusive ?
14% des personnes en situation de handicap affirment ne jamais venir au cinéma, pourtant 84% d’entre eux se disent sensibles aux dispositifs d’accessibilité en salles. Les principaux obstacles à leur fréquentation des cinémas sont : l’absence d’équipements d’accessibilité proposés sur les films comme l’audiodescription ou le sous-titrage, la difficulté à se déplacer et un plus grand confort de visionnage à la maison*. Pourtant, les salles ont aujourd’hui de nombreuses possibilités pour rendre l’exploitation d’un film inclusive.
Afin de diffuser les versions adaptées des films, des solutions techniques ou un matériel d’adaptation peuvent s’avérer nécessaires (boucle magnétique, récepteur de son individuel, application…).
Il est également nécessaire de s’organiser pour que les personnes en situation de handicap aient accès aux lieux ou sur les plateformes où la version est diffusée.
- Quand le film est projeté en festival ou en salles, s’assurer que ce soit dans une version accessible et que les lieux sont eux-même accessibles dans leur intégralité (accès aux salles, aux toilettes et aux tables rondes ; accès à la scène et présence de traducteurs pour les Q&A etc).
- Dans le cas d’une diffusion en ligne, sur les plateformes ou sur les services de médias audiovisuels à la demande (SMAD), vérifier les normes des players et notamment qu’ils permettent d’intégrer une deuxième piste audio*.
Penser également à informer les différents publics de l’accessibilité et l’existence de ces séances adaptées et leurs horaires (en utilisant les termes, pictogrammes et supports de communication adaptés).
Le CNC a mis en place des aides financières afin d’élargir l’offre d’œuvres cinématographiques accessibles aux spectateurs en situation de handicap. Pour plus d’informations, cliquez-ici.
Au-delà d’un impératif social et éthique, l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la création et la consommation de contenu peut représenter une opportunité commerciale et la possibilité d’atteindre une nouvelle audience. Pour plus d’informations, cliquez-ici.
Pour aller plus loin :
- Inclusiv, en partenariat avec la CST & Retour d’Image, Ciné Sens et la CST propose un cycle de formations afin de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap en salle de cinéma, de l’envie de cinéma (communication, accès à l’information, programmation) à l’arrivée en salle (accueil, médiation, technique) ;
- l’association Ciné-Sens propose un module de e-learning permettant de faire le tour des questions qui se posent sur l’accessibilité des séances aux personnes porteuses d’un handicap sensoriel ;
- le guide Cinéma et accessibilité publié par le Ministère de la Culture en novembre 2018 peut servir de référence pour travailler à une exploitation et une diffusion accessible aux personnes en situation de handicap.
Sources : questionnaire Inclusiv ; Rapport de l’Arcom 2021, La représentation du handicap à l’antenne et l’accessibilité des programmes de télévision aux personnes en situation de handicap
Comment l’inclusion des personnes en situation de handicap peut être un levier d’audience pour l’industrie audiovisuelle ?
Au-delà d’un impératif social et éthique, l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la création et la consommation de contenu peut représenter une opportunité commerciale et la possibilité d’atteindre une nouvelle audience.
Une étude récente montre que les personnes en situation de handicap (en particulier les personnes sourdes et malentendantes) font face à un réel manque d’accessibilité dans l’industrie audiovisuelle (en particulier dans le secteur du divertissement) mais désirent ce type de contenu et pourraient y dépenser plus d’argent*.
Par ailleurs, travailler avec des personnes en situation de handicap permet d’entrer en relation avec les communautés de personnes en situation de handicap, ce qui peut augmenter les audiences d’un film ou série. Par exemple, dans le cadre du documentaire américain Crip Camp, une série d’ateliers en ligne sur différents sujets autour du handicap a accueilli plus de 10 000 personnes.
Pour aller plus loin :
- la boîte à outils A Toolkit for Inclusion & Accessibility: Changing the Narrative of Disability in Documentary Film tirée du documentaire américain Crip Camp est une référence en termes d’accessibilité et d’inclusivité, publiée en février 2021 par la FWD-Doc ;
- l’association Ciné-Relax propose des séances de cinéma accessibles aux personnes en situation de handicap ;
- l’association Ciné-Sens propose un un module de e-learning permettant de faire le tour des questions qui se posent sur l’accessibilité des séances aux personnes porteuses d’un handicap sensoriel et recense chaque mois les films avec des versions accessibles en audiodescription (AD), sous-titrage sourds et malentendants (ST-SME) et amplification (HI).
Source : AbilityNet, Businesses are missing out on the purple pound (2019)
Comment rendre les formations audiovisuelles accessibles aux personnes en situation de handicap ?
Les organismes de formations audiovisuelles et cinématographiques ont un rôle particulier à jouer dans la question de la représentation des personnes en situation de handicap : dans la création de contenus et dans la sensibilisation des étudiants à ces problématiques. Pour plus d’informations, cliquez ici.
Au-delà des enseignements, ces écoles doivent évidemment être rendues accessibles. La question du handicap soulève des problématiques extrêmement différentes selon la situation de la personne concernée : comme pour une adaptation de poste, le plus important est de bien comprendre le type de handicap dont il s’agit et les besoins qui lui sont associés, tout en restant ouvert à la mise en place de nouvelles pratiques au “cas par cas” au sein de l’institution. C’est ce que fait La Fémis, qui a lancé depuis quelques années une politique d’accueil et d’inclusion des personnes en situation de handicap.
Il est aussi nécessaire de mettre en avant des éléments concrets qui montrent que la structure favorise l’épanouissement d’un·e élève en situation de handicap, pour permettre aux candidat·es d’envisager ces formations / d’entrer en contact avec elles. Par exemple, en explicitant l’accessibilité des locaux, le matériel spécifique pour garantir le bon déroulement de la formation, la possibilité d’un aménagement particulier lors d’un concours d’admission, etc.
Pour aller plus loin :
- consulter les webinaires de la Ressource Handicap Formation sur le site internet de l’Agefiph (cadre légal, conception d’une salle de cours accessible, pédagogie inclusive, etc) ;
- il est également possible de suivre une formation référent handicap proposée par l’Agefiph (un module particulièrement recommandé par La Fémis).
Niveau 3 : Comprendre en profondeur les ressorts, aides, modalités administratives de l’emploi
Obligations
En tant qu’employeur, quelles sont mes obligations ?
Depuis le 1er janvier 2020,
- toutes les entreprises, quelles que soient leurs effectifs, doivent effectuer une déclaration d’emploi de travailleur handicapé (DOETH) ;
- tous les employeurs, de droit public comme de droit privé, dès lors qu’ils comptent au moins 20 agent·es / salarié·es ont l’obligation d’employer directement 6% de personnes en situation de handicap (5% à Mayotte), pourcentage qui pourra être revu à la hausse tous les 5 ans. Lorsqu’une entreprise franchit ce seuil de 20 salarié·es, elle dispose d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité vis-à-vis de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ;
- si une entreprise n’atteint pas ce seuil, elle se trouve dans l’obligation de verser une contribution financière annuelle à l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (ou Agefiph), d’environ 4000€ HT par travailleur en situation de handicap qui aurait dû être employé ;
À noter : Si cette obligation légale concerne une minorité des entreprises du secteur audiovisuel et du cinéma – la majeure partie des structures comptant moins de 20 salarié·es – l’inclusion est l’affaire de tous et a un fort impact sur les représentations proposées. Pour plus d’informations, cliquez ici.
- jusqu’en 2024, les emplois indirects (via les Établissements ou Services d’Aide par le Travail, les Entreprises Adaptées, les Travailleurs Indépendants Handicapés) permettent cependant de minorer la contribution à l’Agefiph (30% des dépenses HT étant déductibles jusqu’à 50% de la contribution si moins de 3% des travailleurs sont handicapés ; déduction jusqu’à 75% si plus de 3% des travailleurs sont handicapés) ;
- les démarches administratives pour embaucher une personne en situation de handicap sont simplifiées, et s’effectuent via la déclaration sociale nominative comme pour toute personne employée.
Depuis la loi du 12 juillet 1990, le fait de refuser d’embaucher, de licencier ou de sanctionner un·e salarié·e en raison de son état de santé ou de son handicap est un délit. Seul le médecin de travail peut décider si un candidat est apte ou non à exercer un emploi. En cas d’avis d’aptitude, l’employeur ne pourra se fonder sur l’état de santé ou le handicap du candidat.
À noter : Les personnes bénéficiant du statut de travailleur handicapé sont celles qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Les travailleurs handicapés qui entrent dans le cadre de l’OETH sont référencés sur le site du ministère de l’économie, dans la rubrique emploi. Il n’existe à ce jour aucun moyen d’intégrer les personnes en situation de handicap ne bénéficiant pas de la RQTH dans les statistiques d’une entreprise. Néanmoins, certains outils ont été développés, comme le Diamond Diversity Monitoring System au Royaume-Uni, un formulaire anonyme envoyé à tous les membres de l’industrie audiovisuelle, afin de centraliser les statistiques de diversité du secteur. Il peut donc être envisageable de réaliser un dispositif similaire en envoyant un questionnaire anonyme à tous les employés pour établir les statistiques de diversité de son entreprise, incluant ainsi les personnes en situation de handicap ne bénéficiant pas de la RQTH.
Qu’est-ce que l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) ?
Tous les employeurs, de droit public comme de droit privé, sont tenus de respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), dès lors qu’ils comptent au moins 20 agent·es / salarié·es. Cette obligation impose d’employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6 % de son effectif total.
Tous les employeurs, y compris ceux dont les structures comptent moins de 20 salarié·es, doivent déclarer le nombre d’emplois occupés par un travailleur handicapé pour justifier qu’ils respectent leur obligation d’emploi.
Pour plus d’informations, cliquez-ici.
Qu’est-ce que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ? Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
La RQTH est une décision administrative qui accorde aux travailleurs handicapés une qualité leur permettant de bénéficier d’aides spécifiques.
La RQTH est accordée à toutes les personnes dont le lien à l’emploi est compliqué par toute problématique de santé dont les retentissements durent plus d’un an (tout type de handicap y compris endométriose, diabète, lombalgie…). Il faut avoir 16 ans ou plus.
Elle s’obtient à l’issue d’une démarche volontaire de la personne concernée, qui s’effectue auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son département. L’évaluation de la RQTH met entre 1 et 9 mois. Elle est valable pour une durée limitée de 1 à 10 ans, sauf en cas de handicap irréversible où elle peut être accordée de manière définitive.
Certaines personnes n’ont pas besoin de faire de demande de RQTH pour en bénéficier :
- les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % et titulaires d’une rente d’un régime de protection sociale obligatoire ;
- les titulaires d’une pension d’invalidité ;
- les titulaires d’une carte d’invalidité ;
- les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
À noter : Il n’existe aucune obligation d’informer son employeur (ou tout autre organisme avec lequel une personne en situation de handicap serait en contact) de l’obtention de la RQTH. Néanmoins, elle peut permettre de communiquer sur son handicap afin qu’il soit mieux pris en compte.
Pour aller plus loin :
- consulter le site du ministère en charge de l’économie dans la rubrique Emploi et handicap : RQTH ou le site gouvernemental Mon parcours handicap.
Quels sont les droits ouverts par la RQTH ?
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé(RQTH) permet l’accès à un ensemble de mesures favorisant le maintien dans l’emploi ou l’accès à un nouvel emploi, comme des aides à la formation et à l’insertion professionnelle. Les formations peuvent être financées et rémunérées.
Le site internet de la Fédération des associations gestionnaires et des établissements de réadaptation pour handicapés (ou FAGERH) regroupe les formations accessibles aux personnes en situation de handicap, classées par secteur d’activité. Il n’existe pas de formation spécifique aux métiers techniques de l’audiovisuel et du cinéma, mais il existe des formations en infographisme et aux métiers administratifs.
La RQTH permet également d’accéder au dispositif Emploi Accompagné, qui permet à la personne handicapée d’être suivie par un coach dans sa recherche et/ou son maintien en emploi.
Du côté employeur, la RQTH permet de reconnaître le statut de travailleur handicapé et donc d’être pris en compte dans les 6% d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Pour plus d’informations, cliquez-ici.
Recrutement
Y a-t-il des entreprises / organismes vers lesquelles se tourner pour recruter des personnes en situation de handicap dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma ?
Afin de recruter des personnes en situation de handicap dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma, on peut être amené à chercher :
- Des informations : Les Cap emploi sont la structure de référence pour obtenir des informations sur le recrutement d’une personne en situation de handicap, bien que ces structures ne soient pas spécifiques au secteur de l’audiovisuel et du cinéma. Ces organismes de placement spécialisés (OPS) s’adressent aux personnes en situation de handicap qui nécessitent un accompagnement spécialisé et renforcé ainsi qu’aux employeurs (publics et privés) dans le cadre du recrutement et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Il s’agit d’un service gratuit, de proximité et entièrement individualisé. Les services proposés pour les employeurs sont dans une logique d’accompagnement et de suivi, avec notamment des informations sur l’insertion professionnelle d’une personne en situation de handicap, la définition d’un processus de recrutement adapté et la présentation de candidatures cibléesÀ noter : Les Cap emploi se sont actuellement rapprochés de Pôle emploi. En 2025, il n’y aura plus qu’un service nommé “France travail”.
- Des CV/profils : Au même titre que n’importe quel recrutement, celui d’une personne handicapée est tout d’abord une question de compétences, pas de handicap. La plupart des postes de travail peuvent être occupés par une personne handicapée, c’est pourquoi il est nécessaire de mener une démarche inclusive sur toutes les offres d’emploi. Pour plus d’informations, cliquez-ici.Dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma, on peut néanmoins être amené à chercher des profils spécifiques de personnes en situation de handicap. Dans ce cas, il est conseillé de se tourner vers des entreprises spécialisées, comme les agences Singularist ou l’agence Colette pour la recherche de talents artistiques. Il est également possible de mobiliser des réseaux d’anciens du secteur, en contactant des organismes qui font de la formation : le dispositif de formation JARIS propose à des personnes en situation de handicap une formation de 4 mois dédiée aux métiers du journalisme, de l’audiovisuel, du cinéma et du jeu vidéo ; ou l’agence de production audiovisuelle Séquences Clé qui est composée majoritairement de professionnels créatifs vivant avec un handicap.
- Des aides financières : L’Association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées (ou Agefiph) est un organisme ayant pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé. Pour les entreprises du secteur privé, l’Agefiph a mis en place un certain nombre d’aides financières relatives au recrutement d’une personne en situation de handicap. Il est possible de prendre contact directement avec l’Agefiph de sa région afin de mobiliser ces différentes aides et services proposés et construire un plan d’action adapté aux besoins de son entreprise. Pour plus d’informations, cliquez-ici.
- De l’aide juridique ou pratique : Il est possible d’entrer en relation avec la Mission Handicap Spectacle vivant & enregistrement d’Audiens qui propose un accompagnement gratuit et permet une mise en relation avec les structures concernées comme l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (ou Agefiph) ou le réseau Gesat.
Comment mener un recrutement inclusif ?
Recruter une personne en situation de handicap, c’est chercher à embaucher une personne, certes dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, mais surtout motivée et compétente pour un poste donné – loin du cliché du caméraman aveugle ou du technicien du son sourd.
Dans l’annonce :
- expliciter de manière la plus claire possible les missions et les compétences nécessaires, ainsi que les conditions d’exercice du poste ;
- les mentions “poste réservé aux personnes en situation de handicap” ou équivalentes sont interdites afin d’éviter une forme de discrimination positive à l’embauche. Néanmoins, pour inciter l’émergence de candidatures de personnes handicapées, on peut ajouter une formule comme « Les candidatures des personnes en situation de handicap sont bienvenues ! ». Pour ne pas être discriminant, il est nécessaire que cette mention figure de manière générique sur toutes les offres, et pas juste celles qui sont en lien avec des situations de handicap (rôle de personne en situation de handicap pour acteur en situation de handicap, etc) ;
- dans la mesure du possible, mettre en avant des éléments concrets montrant que la structure permet à un·e employé·e en situation de handicap de s’épanouir professionnellement. Il est intéressant par exemple d’expliciter l’accessibilité des locaux, mettre en avant des contenus sur lesquels l’entreprise travaille avec des talents en situation de handicap devant ou derrière la caméra, etc.
Poster ensuite cette annonce de manière la plus large possible notamment auprès de partenaires spécialisés comme le service dédié au handicap de Pôle emploi.
Au niveau du processus de recrutement :
- dans la mesure du possible, proposer plusieurs manières de postuler (par écrit, par vidéo, etc) ;
- prévoir une période de candidature assez longue pour permettre aux personnes qui ont besoin de se faire aider dans leur candidature de postuler ;
- à chaque étape, faire preuve de flexibilité et proposer de s’adapter en fonction des besoins de la personne.
À noter : L’information relative au handicap d’une personne entre dans la catégorie des données sensibles en RGPD, ce qui implique que le traitement de ces données est interdit (sauf dans les cas limitatifs prévus par l’article 9.2 du RGPD).
Pour aller plus loin :
- consulter le guide Guide to hiring disabled production talent in the TV industry de la chaîne britannique Channel 4 (en anglais) ou le guide Pour un recrutement sans discrimination de l’institution Défenseur des droits.
Comment mener un entretien avec une personne en situation de handicap ?
Au moment de l’organisation d’entretiens :
- demander, de manière simple et respectueuse, s’ils ont des besoins d’ajustement ou d’accessibilité à prendre en compte et s’ils ont des préférences sur la typologie d’entretien, le lieu et l’horaire ;
- en cas d’entretiens en présentiel, être vigilant sur l’accessibilité de la salle (absence de marche, présence d’ascenseur, luminosité, etc). Si les locaux ne sont pas accessibles, prévoir un autre lieu pour faire passer les entretiens ;
- en cas d’entretiens en visio, avoir plusieurs options de technologies et de plateformes ;
- anticiper sur les besoins éventuels d’interprète de langue des signes ou d’accompagnant externes.
Durant les entretiens :
- expliciter clairement les conditions d’exercice du poste et se renseigner auprès du ou de la candidat·e sur sa capacité effectuer les missions dans ce cadre, avec ou sans ajustement ;
- mettre l’accent sur les besoins d’ajustement, plus que sur les difficultés et/ou limitations éventuellement liées au handicap ;
- demander au candidat·e s’il ou elle souhaite parler de son handicap / est à l’aise avec le fait que l’employeur pose des questions sur sa situation ;
- s’il y a une tierce personne (interprète, autre), s’adresser toujours au candidat·e.
- ne pas proposer d’ajustements qu’il ne serait pas ensuite possible de mettre en place à cause de contraintes liées au poste (ex accorder du temps supplémentaire pour effectuer certaines tâches, etc) ;
Après les entretiens :
- proposer un échange de retours, à la fois au bénéfice du ou de la candidat·e et pour connaître ses retours sur ce qui a ou non fonctionné sur le processus de recrutement afin de l’améliorer.
Pour aller plus loin :
- le site de l’association La compagnie des aidants met à disposition en ligne une fiche pratique Savoir être et savoir faire avec une personne en situation de handicap, avec des conseils par typologie de handicap ;
- la fiche ressource Recrutement et Intégration d’un travailleur handicapé de la Mission Handicap Spectacle vivant & enregistrement d’Audiens propose également des renseignements, réponses et bonnes pratiques à mettre en œuvre lors du recrutement d’une personne en situation de handicap.
Comment demander à une personne en situation de handicap des informations sur son handicap en tant qu’employeur ?
Il n’y a aucune obligation légale d’informer son employeur sur son handicap ou l’obtention de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Le plus important est de respecter le choix de la personne de parler, ou non, de sa situation. Dans le cas où un·e salarié·e décide de révéler son handicap et afin de s’adapter au mieux à sa condition, il est préconisé de poser des questions relatives aux adaptations de poste nécessaires plutôt que sur le handicap directement. Pour plus d’informations, cliquez-ici. Ainsi, la personne en situation de handicap sera en mesure de révéler ce qu’elle souhaite tout en prenant les mesures nécessaires pour son bien-être dans l’entreprise.
Il faut également respecter l’envie d’informer / sensibiliser, ou non, le reste de l’entreprise et des collaborateurs.
Malgré ces impératifs et la nécessité d’œuvrer pour un accueil et un dialogue respectueux à l’égard des personnes handicapé·es, le principal pour l’employeur est de rester lui-même et détendu, et ce quelle que soit la nature du handicap !
Faut-il privilégier un type de contrat (CDI, CDD, intermittence) pour les personnes en situation de handicap ?
Dans la majorité des cas, la plupart des postes de travail peuvent être occupés par une personne handicapée. Ainsi, il n’y a pas de règle d’or et tous les types de contrats sont mobilisables (CDI, CDD, CIE…).
Dans certains cas de figures ou pour des handicaps plus lourds, garder en tête :
- Les contrats en alternance, sans limite d’âge pour les travailleurs·es handicapé·es, qui peuvent être avantageux afin d’intégrer le salarié handicapé tout en le formant.
- Le cas particulier de l’intermittence, commun dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma, puisque les personnes en situation de handicap avec des limitations de mobilité ont moins de chances d’obtenir des heures de travail en tant que figurant·es ou comédien·nes (que ce soit juste pour l’image ou l’accessibilité des lieux au sens propre). Le régime de l’intermittence peut néanmoins être un atout pour les personnes qui ont besoin de périodes sans travailler pour se reposer et auraient des difficultés à travailler à temps plein (dans le cas où les heures minimales sont effectuées sans difficulté).
À noter : il est possible de bénéficier de l’allocation adulte handicapé (AAH) tout en exerçant une activité professionnelle, notamment si celle-ci est précaire. Cependant, cela implique d’avoir un taux d’incapacité supérieur à 50%.
Faut-il prévoir des clauses supplémentaires dans le contrat d’une personne en situation de handicap ?
Il est préférable de ne pas établir de distinction entre les contrats des personnes en situation de handicap et ceux des autres personnes. Ainsi, il est recommandé d’intégrer les clauses concernant le handicap dans tous les contrats, et de détailler les spécificités dans les contrats des personnes concernées.
Par exemple, décrire dans les contrats généraux que si la personne bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), elle a le droit à des aménagements pour compenser les éventuelles limitations induites par son handicap dans l’exercice de son métier. Dans le contrat d’un travailleur·se handicapé·e concerné·e, une clause viendra détailler les aménagements relatifs à cette personne.
Qu’est ce qu’une adaptation de poste ? Comment adapter un poste à une personne en situation de handicap ?
Dans le cadre du recrutement d’une personne en situation de handicap, où de l’apparition/évolution d’un handicap d’un·e employé·e préexistant·e, une entreprise peut avoir à aménager son poste de travail afin de maintenir le ou la salarié·e dans de bonnes conditions. Pour rappel, plus de 80% des personnes en situation de handicap n’ont pas besoin d’aménagement de poste de travail.
Dans le cas où une adaptation est nécessaire, il est important de bien comprendre s’il s’agit d’un handicap physique, psychique et/ou intellectuel. La collaboratrice ou le collaborateur aura des besoins différents selon ses capacités et son poste. Il est essentiel de dialoguer avec la personne concernée afin de s’ajuster au mieux à sa situation tout en respectant son intimité. Pour plus d’informations, cliquez-ici.
Ces mesures d’accompagnement peuvent comprendre:
- l’accessibilité aux locaux ;
- un aménagement de la charge de travail, des horaires ou du temps de travail ;
- un aménagement de l’espace de travail (siège ergonomique, adaptation de l’éclairage, atténuation du bruit) ;
- la mise en place de logiciels ou outils spécifiques (écran adapté) ;
- le besoin d’explications complémentaires, de tutorat, d’interprétariat ;
- le besoin d’être rassuré ou accompagné.
Ces solutions peuvent être le résultat d’échanges avec le médecin de santé au travail qui évaluera les solutions possibles en fonction de la situation du ou de la salarié·e et proposera des mesures d’aménagement à mettre en place pour faire correspondre le poste et ses capacités.
À noter : Il existe une aide de l’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (ou Agefiph) accordée pour financer l’adaptation d’un poste à un handicap et prendre en charge le surcoût des équipements spécifiques nécessaires mis à disposition par l’employeur. Pour plus d’informations, cliquez-ici. Le montant de l’aide est évalué après une analyse de la situation dans une logique de compensation du handicap.
Pour aller plus loin :
- consulter le site de l’Agefiph, dans la rubrique aide à l’adaptation des situations de travail des personnes handicapées.
Aides
Quelles sont les aides disponibles dans le cadre du recrutement d’une personne en situation de handicap ?
L’Association nationale de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (ou Agefiph) propose de nombreuses aides relatives à l’embauche de personnes handicapées. Ces aides peuvent permettre de prendre en charge le surcoût des dispositifs humains, techniques ou organisationnels relatifs à l’intégration d’une personne en situation de handicap au sein de l’entreprise.
Les aides disponibles sont détaillées sur le guide Metodia de l’Agefiph, dans la rubrique aides financières.
Lorsqu’il s’agit de tournages, les aides liées à l’aménagement de poste sont rarement octroyées en raison de la courte durée d’emploi de la personne en situation de handicap. Les aides relevant du soin (ostéopathie…) ne sont pas non plus prises en charge. Parmi les aides fréquemment accordées, on trouve principalement des aides au déplacement (remboursement VTC…) et à l’accompagnement des personnes handicapées (aides humaines, coaching…) :
- jusqu’à 12 000€ par an pour une aide aux déplacements en compensation du handicap ;
- 4 200€ par an pour une aide humaine ;
- pour des séries sur plusieurs saisons, les aménagements de poste peuvent être envisagés en raison d’une durée de tournage prolongée.
Pour les aides plus classiques (qui peuvent donc servir pour des sociétés de production ou de distribution) on trouve également :
- jusqu’à 4 000€ pour l’emploi d’une personne en situation de handicap dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 6 mois minimum (le montant est calculé au prorata du temps de contrat) ;
- jusqu’à 5 000€ pour un contrat de professionnalisation (le montant est calculé au prorata du temps de contrat) ;
- 3 150€ pour une aide à l’accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle d’une personne en situation de handicap (tutorat, coaching) ;
- l’adaptation des postes de travail aux personnes en situation de handicap (le montant est évalué après analyse de la situation dans une logique de stricte compensation du handicap) ;
- l’aide liée à la reconnaissance de la lourdeur du handicap (RLH), ayant pour objectif de compenser des surcoûts permanents liés au handicap d’un·e salarié·e. Pour en bénéficier, il faut adresser un formulaire de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap (6000€ ou 12 300€ selon le taux de lourdeur du handicap, normal ou majoré).
La demande d’aide doit être faite directement sur le site internet de l’Agefiph, en déposant un dossier principalement composé de devis justificatifs des dépenses supplémentaires. Les aides ne sont pas rétroactives : la demande doit être faite en amont et sera traitée par une branche de l’Agefiph rattachée à la région du siège social de l’entreprise. Après validation du dossier, les paiements seront effectués sur facture.
Pour aller plus loin :
- consulter le site de l’Agefiph, dans la rubrique services et aides financières.
Existe-t-il des aides pour rendre la diffusion et / ou l’exploitation d’un film / série inclusive ?
Afin de rendre la diffusion et/ou l’exploitation d’un film ou série accessible (sous-titrage, audiodescription, investissement pour la création ou la modernisation des salles de cinéma), il existe plusieurs aides mises en place par le CNC, qui concernent l’ensemble des acteurs du secteur :
- Producteur délégué : sous titrages et audiodescription multi-supports des films d’initiative française (montant est plafonné à 50 % des dépenses éligibles justifiées).
- Distributeur : sous-titrage et audiodescription multi-supports des films étrangers ou de coproduction française (sous réserve de l’examen d’une commission, pour une œuvre dont les frais de sortie n’excèdent pas 550 000 €).
- Exploitant : investissement pour la création ou la modernisation des salles de cinéma (permet de récupérer 90 % du montant des travaux).
Pour aller plus loin :
- consulter le guide Cinéma et accessibilité du Ministère de la Culture publié en 2018.
Arrivée
Comment continuer à s’informer et faire bouger les lignes du handicap dans le secteur audiovisuel et du cinéma ?
- S’inscrire à la newsletter de l’Observatoire des images et nous suivre sur les réseaux sociaux afin de connaître les actualités du secteur à ce sujet et rejoindre nos actions futures ;
- Lire l’étude de cas détaillée A Toolkit for Inclusion & Accessibility: Changing the Narrative of Disability in Documentary Film tirée du documentaire américain Crip Camp publiée en février 2021 par la FWD-Doc ;
- Partager cette base de connaissances et en parler à un maximum de personnes du secteur ;
- Ne pas hésiter à faire remonter les problèmes rencontrés en lien avec l’employabilité des personnes en situation de handicap à l’Observatoire des images ou à d’autres associations / institutions qualifiées (CNC, Agefiph…) ;
- Lire et regarder les projets avec un œil nouveau !
L’Observatoire des images est le premier organisme regroupant celles et ceux qui s’intéressent au rôle des images au cinéma, à la télévision, dans les jeux vidéos et dans les publicités.
Nous menons des actions de plaidoyer et de sensibilisation notamment auprès des professionnel·le·s, de développement de la recherche, de formation du public et d’éducation aux médias.