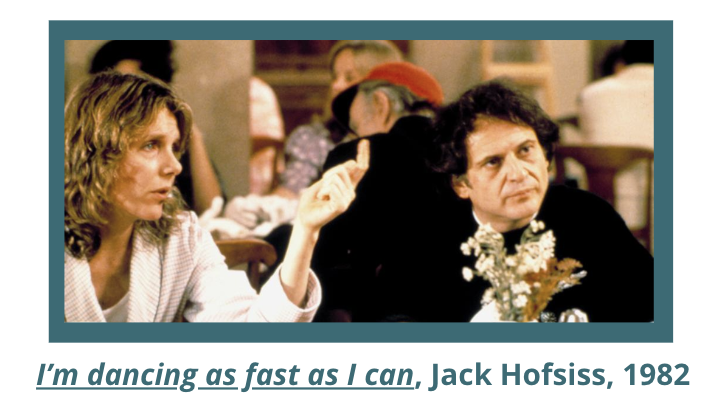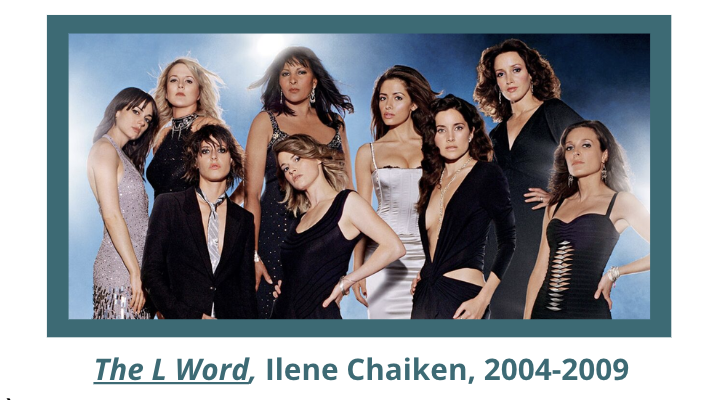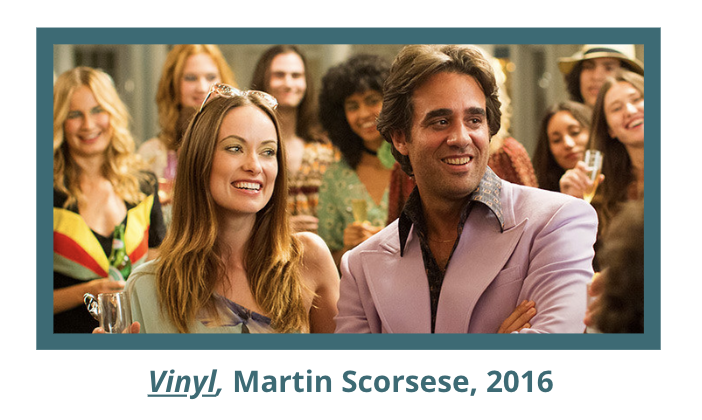FOCUS
#30
Avez-vous déjà vu… une réalisatrice à l’écran ?
Avec Noémie Alekanian, doctorante à l’Université Paul Valéry – Montpellier 3 en Études cinématographiques, et en collaboration avec le Lab Femmes de cinéma, un think tank qui travaille sur la parité et la mixité dans le cinéma et l’audiovisuel.
En synthèse : Malgré une augmentation du nombre de réalisatrices à Hollywood, ces dernières continuent d’être invisibilisées dans les mises en abyme cinématographiques et télévisuelles. Ces productions entretiennent des stéréotypes de genre, particulièrement à travers leur construction d’une image masculine et toute-puissante du réalisateur, qu’il est urgent de bousculer.
Si le cinéma, puis la télévision, se sont interrogés sur leur propre existence dès leurs débuts, montrant et fantasmant les coulisses des plateaux de tournage et des studios, la mise en abyme semble être un sujet d’autant plus populaire ces dernières années. Sur grand écran, se sont enchaînés les films Once Upon A Time… In Hollywood (2019), The Fabelmans (2022), Babylon (2022), The Fall Guy (2024), etc. La télévision et les plateformes se sont également saisies de ce thème dans des productions telles que Feud (2017), Hollywood (2020), The Offer (2022) et Swimming with Sharks (2022).
Ce regain d’intérêt semble intervenir à la suite du bouleversement provoqué par #MeToo en 2017. L’industrie du cinéma fait, dès lors, l’objet de beaucoup d’attention quant aux rapports de force qui le structurent, plus particulièrement en matière de sexisme, ce qui influence ses représentations dans les films et les séries. Voit-on, pour autant, plus de personnages de professionnelles du cinéma sur nos écrans ? Si les réalisatrices sont plus nombreuses ces dernières années, représentant 16% des personnes en charge de la réalisation des films à Hollywood en 2023, une part qui a doublé depuis 1998, cette évolution se voit difficilement à l’écran.
RÉALISATEUR : UN MÉTIER FILMÉ AU MASCULIN
En situant leurs intrigues dans les studios des grosses compagnies, les films sur Hollywood mettent en scène de nombreuses personnes qui travaillent à faire vivre l’industrie du cinéma. Les femmes sont généralement des actrices à la recherche de succès, parfois des secrétaires, tandis que les professions techniques et créatives sont occupées par les hommes, dont le poste de réalisateur : King Kong (1933, 2005), Stardust Memories (1980), Chaplin (1992), Hitchcock (2012), Avé César (2016), etc. On serait tenté d’expliquer cette division genrée du travail cinématographique à l’écran par l’absence de femmes dans la profession. Ally Acker a pourtant démontré dans son ouvrage Reel Women : Pioneers of the Cinema (1991) que, jusque dans les années 1930, quand le cinéma manquait de légitimité culturelle et ne s’était pas encore structuré en industrie lucrative, il y avait de nombreuses réalisatrices dans les studios. Le manque de représentation de ces pionnières résulte, et reconduit à son tour, leur invisibilisation et leur effacement de la mémoire collective.
En 1982, l’autobiographie best-seller de la documentariste télévisée Barbara Gordon est adaptée au cinéma sous le titre I’m Dancing As Fast As I Can. À l’occasion de ce biopic, on montre enfin l’histoire d’une femme réalisatrice, certes, mais qui réalise des documentaires pour la télévision, un genre filmique et un médium traditionnellement dévalorisés par rapport au cinéma de fiction, et dont la pratique va être éclipsée par des problèmes d’ordre privé (addiction, désordre psychologique, compagnon abusif, etc.). Un tel film renforce des stéréotypes de genre qui entretiennent une conception masculine du métier de réalisateur. Depuis, aucun autre destin de réalisatrice n’a été porté sur le grand écran contrairement aux nombreux biopics sur des réalisateurs (Ed Wood, Chaplin, Aviator, Hitchcock, The Fabelmans, etc.).
LES SÉRIES : UNE PLACE AU SOLEIL POUR LES RÉALISATRICES ?
Quand le cinéma ferme une porte, la télévision ouvre parfois une fenêtre. Considérées comme des médiums moins légitimes, la télévision et les plateformes de streaming constituent une meilleure voie d’accès à la réalisation pour les femmes. Bien que la parité soit encore loin d’être atteinte, le pourcentage de créatrices est de 23% dans les programmes télévisés et de 29% dans les programmes de streaming en 2022-2023. Selon Geneviève Sellier, spécialiste du genre, les séries mettent davantage en scène des discours et des personnages alternatifs qui s’opposent à la vision patriarcale dominante du cinéma. En effet, la présence de davantage de femmes à ce poste semble permettre de voir plus de personnages de femmes dans les intrigues sérielles consacrées au monde du cinéma et à la fabrication des films, notamment des figures de réalisatrices. Par exemple, The L Word (2004-2009), une série créée et écrite par des femmes, fait de sa protagoniste, Jenny Schecter, la réalisatrice d’un film à gros budget quand un studio hollywoodien souhaite adapter son scénario sur le quotidien d’un groupe de femmes lesbiennes.
Dans un monde où les femmes n’ont pas encore leur place, ces séries montrent la grande fragilité de la position des réalisatrices qui, pour réussir – ou seulement survivre – doivent prendre activement part, à leur tour, à la reproduction des rapports de domination. Dans The L Word, sous la pression de son producteur, Jenny adopte des codes visuels masculins et hétérosexuels pour filmer ses actrices comme des objets de désir, mais ceux-ci ne lui permettent pas, en définitive, de conserver son poste. Tandis que, dans Brand New Cherry Flavor (2019), une jeune réalisatrice, qui a été dépossédée de son film par son producteur pour avoir refusé ses avances, se montre elle-même abusive vis-à-vis de son actrice, participant pleinement à l’oppression des femmes par l’industrie dominante. La minisérie The Romanoffs (2018) pousse l’idée à son paroxysme en consacrant un épisode au harcèlement exercé sur une actrice par la réalisatrice et son équipe de tournage qui vont jusqu’à provoquer sa mort.
À une époque où le concept de sororité a refait surface avec le mouvement #MeToo, les séries prolongent l’image d’une rivalité forte entre femmes à Hollywood. Pourtant, la solidarité féminine a été essentielle pour rendre accessibles certaines positions aux femmes. Dans les années 1980 et 1990, quand des professionnelles telles que Dawn Steel et Sherry Lansing, respectivement dirigeantes des studios Columbia Pictures et Paramount Pictures, sont parvenues à occuper des postes à hautes responsabilités, elles embauchent davantage de femmes aux postes de réalisatrices, productrices, scénaristes, etc. Du côté de la production des séries, la présence d’au moins une femme à la création entraîne également un nombre plus important de femmes parmi les équipes créatives et techniques : par exemple, quand au moins une femme occupe le poste de créatrice, les femmes représentent 38% des personnes en charge de la réalisation des épisodes, contre seulement 12% dans le cas contraire. Cette dernière décennie, les professionnelles se sont également beaucoup mobilisées au travers d’actions telles que l’initiative Alice, créée en 2016, regroupant des femmes cadres de studios hollywoodiens qui s’engagent à prendre des femmes réalisatrices dans leurs projets de films. En France, le think tank Lab Femmes de cinéma engage également de nombreuses actions en ce sens depuis sa création en 2017. Ainsi la mise en scène de femmes abusives par les séries est loin d’être le reflet de la réalité : s’inscrirait-elle dans une tradition plus longue de rivalité féminine profitant au patriarcat, en réaction au mouvement #MeToo ?
Bien qu’elles mettent en scène davantage de femmes réalisatrices, les séries ne sont donc pas exemptes de tout reproche. En outre, ces productions ont connu un regain de légitimité ces dernières années, qui a entraîné davantage de grands noms du cinéma, principalement des hommes, à s’essayer à la création et à la réalisation de séries pour la télévision ou les plateformes : Vinyl (Martin Scorsese, 2016), Mindhunter (David Fincher, 2017), Wednesday (Tim Burton, 2023), etc. Alors que les séries acquièrent progressivement leurs lettres de noblesse, on peut craindre que le phénomène qui a eu lieu dans l’industrie cinématographique ne se répète. Autrement dit : les femmes vont-elles se voir évincer des postes de créatrices, puis disparaître également de nos petits écrans en tant que personnages ? Les chiffres sont en baisse : entre 2019 et 2023, le pourcentage de créatrices de télévision a diminué de 6%. Leur nombre n’avait pourtant, jusque-là, pas baissé depuis des années.
Que ce soit au cinéma où elles sont quasi inexistantes, ou dans les séries où elles ne parviennent pas à conserver leur place, Hollywood apparaît sur nos écrans comme un milieu dans lequel il est impossible pour les réalisatrices de faire carrière. Quand bien même leur présence au cours des premières décennies du cinéma est un fait établi, l’imaginaire cinématographique rattaché à la profession occulte quasi totalement ce pan de la réalité. Récemment, le film Babylon a néanmoins tenté de corriger cet oubli à travers la mise en scène de Ruth Adler, une réalisatrice de comédies burlesques dans les années 1920, mais son personnage demeure très secondaire. Les efforts entamés depuis les années 1990, qui se sont intensifiés avec le mouvement #MeToo depuis 2017, ne sont pas beaucoup plus significatifs sur le petit écran où la représentation de la profession continue d’adopter des codes masculins, aux Etats-Unis comme en France. Par exemple, la série Fiasco sur Netflix montre un réalisateur qui a des difficultés à s’assumer comme tel, c’est-à-dire à affirmer son autorité et malmener ses collègues, et qui se voit alors voler sa place par le réalisateur du making-of. Même quand le réalisateur est un homme, il doit respecter ce modèle de domination masculine sous peine d’être puni.
Il faut donc mener deux combats de front : agir sur nos imaginaires à travers une redéfinition des films et des séries sur Hollywood et poursuivre activement la lutte pour plus d’inclusion dans le secteur du cinéma et de l’audiovisuel.
L’Observatoire des images, créé en 2021, est le premier organe associatif regroupant celles et ceux qui s’intéressent au rôle des images au cinéma, à la télévision, dans les jeux vidéos et dans les publicités, notamment sur Internet. Convaincu.e.s que les images peuvent figer les représentations et enfermer dans des stéréotypes, ou au contraire permettre l’émancipation et ouvrir le champ des possibles, les partenaires de l’observatoire se sont réunis pour réfléchir et agir ensemble, que ses membres travaillent dans la production, la distribution, le financement, la communication, la recherche, les institutions…
Les objectifs de la coalition sont notamment de : sensibiliser les pouvoirs publics, les professionnels et le public ; développer la recherche sur la réception des images et mettre en lumière les travaux existants ; agréger et soutenir les pratiques professionnelles ; valoriser les projets et les équipes soucieux de lutter contre les clichés.
Rejoignez-nous : observatoiredesimages.org